Le Manifeste Métaludique et la guerre des définitions
En février dernier est apparu sur le net un Manifeste Métaludique, co-signé par cinq collègues et amis : Julien Prothière, Gaspard Fontanille, Henri Kermarrec, Juan Rodriguez, Antoine Tissot et Agnès Largaud. Pour avoir été brièvement associé à son élaboration, son contenu n’était pas pour moi une surprise, mais j’attendais avec curiosité son aboutissement et les réactions qu’il allait provoquer.
Le Manifeste Métaludique tient en trois points :
- Le jeu n’est pas qu’un produit commercial et n’est pas défini par le divertissement qu’il procure
- Du coup, il peut être plein d’autres choses qui ne répondent pas directement aux attentes du marché (ou de ce que les gardiens du temples croient être les attentes du marché). Les auteurs du Manifeste ont opté pour le terme chapeau “expérimental”, qui ouvre la porte à toute une liste d’autres adjectifs.
- Il est notamment un objet politique.
Du coup : polémique !
Les objectifs de ce texte ne sont pas clairs : il ne s’agit ni d’une feuille de route pour atteindre un objectif concret, ni d’une prescription à faire des jeux d’une certaine manière. Alors quoi ? Comme l’ont expliqué à répétition les signataires dans leurs commentaires ou leurs interviews, leur but est “d’engager le dialogue”, de questionner publiquement certains dogmes largement acceptés dans le milieu ludique afin que chacun puisse exprimer son opinion, entendre d’autres points de vue, et peut-être s’ouvrir à de nouvelles idées.
De fait, à la suite de cette publication, les réseaux sociaux ludiques sont entrés en ébullition. Un certain nombre de voix se sont élevées pour rejeter en bloc le Manifeste. Je trouve que leurs propos reposent sur deux types de réactions (attention, grosses généralités en approche) :
- Un rejet émotionnel, que l’on pourrait traduire par “Je prends plaisir à jouer sans me poser toutes ces questions et j’ai l’impression que vous m’accusez d’être une mauvaise personne. Allez vous faire voir.”
- Un rejet théorique, qu’on peut résumer par “Ce que vous prônez, ce n’est pas du jeu.”
Il y a un certain nombre de personnes (pas toutes) chez qui ces deux réactions coexistent, et les objections théoriques ne sont là que pour légitimer le rejet émotionnel qui se cache derrière. Ce sentiment d’être jugé est assez compréhensible. Bien que les signataires du Manifeste aient clarifié et nuancé leurs propos par la suite, le texte d’origine se veut délibérément assertif. Cela ne rassure pas les lecteurs qu’on ne cherche pas à les critiquer eux, leur pratique du jeu, ou le plaisir qu’ils en retirent.
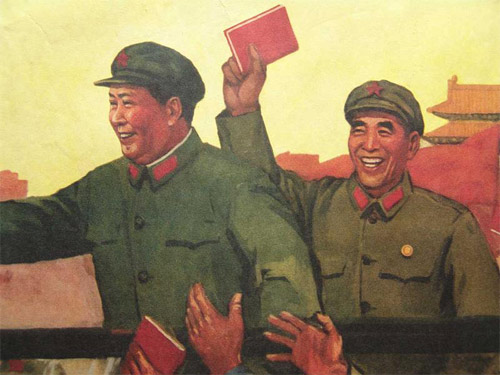
J+1 : certains détracteurs du Manifeste le comparaient déjà à de l’endoctrinement soviétique. « C’est très grave ! » insistaient-ils.
Mais ce serait fuir le débat d’idée que de réduire les oppositions au Manifeste à une réaction émotive due à un malentendu. Il y a aussi des arguments de fond qui ne peuvent pas être simplement niés et qui doivent être considérées avec respect si on veut pouvoir les dépasser. Ils reposent sur une certaine vision du jeu, largement acceptée dans le milieu depuis de nombreuses années au point que c’est la première définition (et souvent la seule) que vont rencontrer les gens que ça intéresse.
Cette vision intègre deux idées fondamentales qui ne datent pas d’hier :
- celle du cercle magique, formulée par Johan Huizinga dans son essai Homo Ludens (1938), qui établie le jeu comme une activité distincte du monde réel.
- celle du jeu gratuit, improductif, formulée par Roger Caillois dans son essai Les jeux et les Hommes (1951), qui insiste sur l’aspect autotélique du jeu, c’est-à-dire qu’on joue par plaisir et pas en espérant un gain par derrière.
Pour plus de clarté, appelons cette vision « le jeu comme distraction inutile ». Le Manifeste semble dire tout le contraire. Pour lui, le jeu n’est ni distinct du monde réel (puisqu’il est politique), ni inutile, ni même forcément distrayant. Ceux qui croient aux principes énoncés par Caillois et Huizinga ne peuvent donc que le rejeter.

Roger Caillois : « On joue pour kiffer, et c’est tout »

Johan Huizinga : « Le jeu, c’est pas la vraie vie »
Malheureusement, ces formules ont peut-être été trop efficaces, et en se propageant au-delà de leur contexte elles ont échappé à l’intention de leurs auteurs. Combien parmi les défenseurs de ces idées ont réellement lu Homo Ludens ou Les Jeux et les Hommes ? Caillois, sociologue, détaille dans son livre de multiples fonctions sociales remplies par le jeu, terme auquel il accorde un sens très vaste puisqu’il englobe le théâtre, les manèges, et certaines cérémonies religieuses. Je n’ai pas moi-même lu Homo Ludens, mais la description du livre sur le site de l’éditeur indique “Johan Huizinga montre la présence extrêmement active et féconde de ce jeu dans l’avènement de toutes les grandes formes de la vie collective : culte, poésie, musique et danse, sagesse et science, droit, combat et guerre.” On est loin d’un escapisme radical et décomplexé.
De plus, ces définitions du jeu sont loin d’être les dernières. Plus récemment, de nombreux game designers parmi les plus grands de la profession ont tenté de décrire avec leurs propres mots les contours et les propriétés de leur sujet d’expertise. Chris Crawford, Jesse Schell, Eric Zimmerman, Ralph Koster, Sid Meier, pour n’en citer que quelques-uns. Certains reprennent à leur compte l’idée du jeu comme distraction inutile. D’autres passent complètement dessus et parlent d’autre chose. D’autres contestent frontalement cette notion. Crawford et Koster décrivent explicitement le jeu comme un terrain d’entraînement pour développer ses compétences sociales, physiques et cognitives sans risquer de répercussions négatives dans le monde réel. Cela ne réduit en rien le plaisir tiré de cette activité, au contraire : c’est parce que le jeu nous permet de croître en tant qu’individu que notre cerveau en retire du plaisir. Comme disait Crawford : “Si un homme préhistorique trouvait une activité utile pour sa survie, nous la trouvons fun.”

Crao : « Une partie de fléchettes, les gars ? »
Alors, qui a raison ?
Qui comprend le mieux la nature du jeu : un sociologue et un historien du siècle dernier, ou des game designers contemporains célébrés par leurs pairs comme par le marché ? La question n’est pas là. On n’ira pas loin en formant des chapelles qui se battent pour savoir quelle définition est meilleure.
Je vois dans cette polémique un symptôme de notre rapport problématique aux définitions. Elles remplissent notre besoin de sens en réduisant un phénomène complexe à quelques mots faciles à comprendre. La plupart du temps, la première définition qu’on entend est pour nous la bonne : elle formate notre vision du réel et nous enlève l’envie d’aller chercher plus loin. On l’accepte comme un dogme universel, immuable, exhaustif, exclusif.
Ne vous méprenez pas : je kiffe les définitions du jeu. J’en ai bouffé pendant mes études et après, j’en ai nourri mes élèves, je trouve ça super. Mais on oublie parfois qu’elles ont été imaginées par des personnes à un instant T pour partager leur compréhension limitée d’un phénomène. D’autres personnes peuvent proposer d’autres définitions parce que leur expérience à elles ne satisfait pas des termes choisis par la première. Lorsqu’on parle d’un phénomène aussi vaste et polymorphe que le jeu, chacune de ses occurrences peut cocher ou non certaines cases de certaines définitions en fonction des cas.
Quelques exemples :
- le jeu est un mouvement libre à l’intérieur des contraintes d’un système de règles -> pas le jeu libre des enfants
- le jeu est une série de choix intéressants -> pas la bataille ou le jeu de l’oie
- le jeu est une activité dont le résultat est incertain -> pas bon nombre de jeux vidéo, qui ne se finissent que d’une seule façon
- les joueurs jouent par plaisir et ont toujours le choix de jouer ou non -> pas dans le cadre d’une pratique compétitive ou professionnelle
- le jeu est coupé du réel et n’a pas de conséquences sur la vraie vie -> pas les jeux d’argent, les jeux à boire ou le sport. Aucun jeu, en fait, n’est complètement coupé de la vraie vie. Ne serait-ce que le temps qu’on y passe a un impact.
Pourtant, aucun des critères de ce pot pourri n’est vraiment faux ou inintéressant pour comprendre ce qu’est un jeu. Ils sont cochés dans beaucoup de cas. Mais aucun n’établit une distinction absolue entre ce qui est du jeu et ce qui n’en est pas. On s’épargnerait beaucoup de discussions pénibles en regardant les différentes définitions du jeu non pas comme des principes antagonistes dont l’un doit triompher, mais comme des outils supplémentaires pour penser le jeu dans toute sa complexité.

On remarquera que je me suis épargné de donner un exemple sur la dimension politique du jeu. En effet, de tous les auteurs que j’ai cité, aucun n’a jugé bon de définir le jeu comme étant apolitique. L’histoire des jeux, comme celle de n’importe quelle autre forme artistique ou culturelle, ruisselle d’idéologie. Que l’on considère les figures aristocratiques imprimées sur les cartes ou les pièces des échecs, les origines moralisatrices du jeu de l’oie, la création controversée du Monopoly, l’essor des simulations géopolitiques pendant la guerre froide, ou récemment Daybreak venant occuper la scène du Spiel l’an dernier, les cas de jeux s’inscrivant ou réagissant à l’air du temps sont innombrables.
Bien sûr, tous les jeux ne sont pas obligés d’avoir cette approche. Tous les joueurs ne sont pas obligés de penser politique chaque fois qu’ils sortent un paquet de cartes. Si ça ne vous intéresse pas personnellement, c’est okay, et c’est okay de le dire. Mais vous perdrez beaucoup de temps et d’énergie à essayer de démontrer que, par définition, ça ne devrait jamais intéresser personne.
Le Manifeste porte la parole d’auteurs frustrés de se voir répéter par des gens qui n’y ont pas réfléchi plus que ça que leurs questionnements et leurs recherches artistiques sont illégitimes. En jetant un pavé dans la mare, ils espèrent mettre en lumière le dogme implicite qui étouffe tout un pan de la discussion critique. Rédiger ce document leur a demandé du temps, de l’effort, du courage. J’espère qu’à terme, cela permettra au public d’avoir accès à des jeux plus variés, plus sincères et plus riches EN PLUS de tout ce qui existe déjà. Rassurez-vous, ils ne veulent rien enlever à personne.


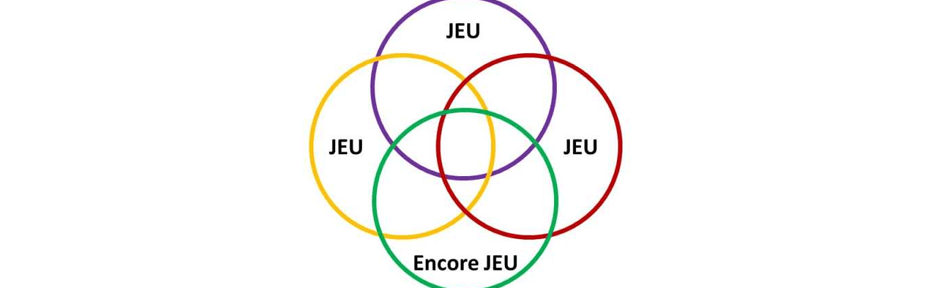




Ihmotep 20/03/2025
Merci pour ce retour très éclairant, triste reflet de la société actuel. J’avais vu la news sur la manifeste, je ne m’y suis pas plus intéressé que cela mais c’est toujours bien de jeter des pavés dans la marre, de faire naître des conflits sociaux cognitifs afin de parfaire notre pensée, la faire évoluer. Je regrette que derrière il faille que ca tourne à la polémique :(. Hélas les exemples se multiplie de cas où la divergences d’opinions devient une guerre d’opinion. Je n’achèterai pas une Tesla par choix ethique mais je ne jette pas la pierre à mes amis qui en ont une. De là à aller bruler des voitures c’est le retour de l’obscurantisme et de la voix « du plus fort », phénomènes fortement accentués par la dérive actuelle des réseaux sociaux.
Personnellement je joue à des jeux vidéos depuis très petits. Je me détache donc fortement des contenus (sinon je ne pourrais pas jouer à un Call Of Duty). Cependant mon jeu préféré est « La Famiglia ». Je comprend que des joueurs puissent ne pas adhérer au thème, et refuse d’y jouer. Mais j’ai déjà aussi été fortement pris à partie et critiquer pour mon choix de jeu. D’autres ont surement fait les frais de réactions similaires, d’où un ressenti de culpabilisation renforcer par le manifeste. Dans les années 90 nous jouions à « Supergang » qui est bien pire dans le fond que ne l’ai « La Famiglia », sans que cela ne choque personne. La société évolue, les regards, les états d’esprit. J’adore les jeux à thèmes, certains m’ont beaucoup appris, d’autres j’y joue de façon plus détaché. Finalement nous changeons de casquettes, de profils joueurs d’une table à l’autre, en fonction du jeux, en fonction des partenaires de jeux.
Ce que je regrette c’est le devoir de mémoire de l’histoire. Les éditeurs ne veulent pas s’attirer les foudres des joueurs, les questions se posent sur les implications d’un joueur dans un jeu, dans son thème. Five Tribes retire les esclaves, Great Westerne Trail les indiens, pour faire des jeux moins polémiques. Alors surement que beaucoup sont gênés de jouer des cartes esclavages. Personnellement je ne me sens pas esclavagiste si je fais cela, ni ne le prône. Pas plus que je ne me sens assassin dans un jeu de tir. Toutefois en éliminant ces éléments des jeux nous « effaçons » des leçons de l’histoire.
Aujourd’hui beaucoup de croit pas en la Shoah (manque de preuves historiques, photos nazis ne montrant pas la réalité des camps, et de moins en moins de témoins vivants). Aujourd’hui des jeunes ne comprennent pas les mouvements pour l’égalité des blancs et des noirs (les jeux et séries TV historique occultant de plus en plus la discrimination de couleurs, réalité encore trop présente aujourd’hui), etc…
C’est un grand débat, et comme il n’y a pas de solutions absolues mais des divergences d’opinions, j’espère que la polémique évoluera vers un respect mutuel des uns des autres car le jeu de société attire tout de même une communauté de personnes tournées vers les autres de part sa nature même (il y a quand même « société » dans l’intitulé ^^)
Bravo pour le travail et la réflexion derrière le manifeste métaludique.
Pascal TERRACOL-CHAMPIN 23/03/2025
La base de ce qui défini le jeu est FAIRE SAMBLANT (Faire s’amblant c’est toujours faire n’est-il pas ?). Si les enfants acceptent leur condition d’enfant (organisée, gérée, dirigée par le monde des adultes) c’est uniquement grâce au fait que jouer c’est pouvoir faire même si cela est « pour de faux ».
Comme j’écris souvent « Si le jeu permet aux enfants d’entrer dans notre monde d’adulte, il permet à l’adulte d’en sortir »
– Comprendre ce que JEU veut dire-.
Donc, vous être cohérent quand vous revendiquez de vouloir jouer à des jeux de société dont le thème est sensible ou symboliquement violent puisque le jeu n’est pas un outil de propagande, étant sans projection, sans but autre que celui de la règle du jeu. Revenons-en donc à Roger Caillois qui annonce le jeu comme une activité non productive et non rentable, donc sans obligation de résultat, sans évaluation.
Le thème illustré et symbolisé par les supports, les pièce ludiques, les pièce set accessoires ludiques, permet l’immersion dans un narratif fictif, même s’il fait référence, de près ou de très loin, à un événement, une civilisation, un sujet de société.
Au cours d’un festival de jeu, j’ai joué à un jeu « engagé écologiquement » de Julien Prothière (dont je n’ai pas mémorisé le nom), sur le thème de l’écologie, de la production de Pétrole et les énergies durables. Ce jeu de cartes associe une application pour téléphone mobile, dont le narratif est influencé par l’esprit général des rapports du GIEC et par dogmes du Forum Economique Mondial. Quand on s’intéresse un peu au sujet, par des réseaux alternatifs, inutile de vous dire que les éléments de références du monde globaliste et des grands médias sont légions, tenant plus du message dogmatique que de la réalité. Ce nonobstant ce constat, j’ai tout de même pris du plaisir à jouer au jeu des frères Prothières, même si je suis en total désaccord avec le narratif du jeu.
C’est la démonstration que la mécanique ludique est prépondérante pour légitimer un jeu de règle, à partir du moment ou mécanique ludique supports narratifs = sont plausible et pas forcément « applaudissables ». C’est la raison pour laquelle il existe encore beaucoup de jeux abstraits. C’est aussi la raison d’être des jeux que je nomme « Hybrides » ou « Abstractifs », c’est à dire des jeux qui s’habillent d’un thème de manière purement ornementale, sans le rendre indissociable des mécaniques et supports ludique (comme par exemple les ACHECS, AZUL, DONUTS, OSIS & OSIRIS).
Tant que l’on joue tout va bien, tout est possible, n’est-il pas ?
Stéphane 20/03/2025
Et pourquoi le jeu ne pourrait pas avoir plusieurs définitions valables et différentes en même temps?
Différentes personnes, différentes personnalités, différents goûts, différents jeux et définitions…
Une vraie tempête dans un verre d’eau. Et pour tout ceux qui réagissent très négativement, on peut rappeler que la société et tout ce qui la compose n’est pas obligée de se conformer à leur vision des choses et que c’est quelque chose à accepter.
En fait, le jeu est de l’art car il est un reflet de notre personnalité et qu’il touche émotionnellement.
Toutes ces définitions différentes ne sont ni vraies, ni fausses puisqu’il ne s’agit que de point de vues.
Conan le berbère 23/03/2025
C’est une définition un peu réductrice du jeu. Le thème du jeu ayant été au programme de je ne sais plus quel machin de l’Education Nationale il y a quelques années, on trouve énormément de doc sur le thème, et le « faire semblant » (qui n’est pas du tout équivalent à l’échappatoire que vous revendiquez pour les adultes) n’est qu’un seul aspect de ce que le très très large corpus disponible permet de survoler.
C’est surtout une définition très réductrice de ce que font les enfants. Jouant énormément avec des enfants, je suis loin d' »organiser, gérer, diriger » leur jeu ou leur activité. Ce serait devenir leur Maître de jeu dans la vie réelle, avec accent sur le railroading: une conception un peu archaïque, me semble-t-il, non seulement de l’éducateur, mais du parent et de l’adulte. On peut organiser un espace, en le laissant à disposition des enfants, sans le gérer ni le diriger, choses qu’ils font très bien eux-mêmes si on leur en laisse l’occasion. On peut également gérer les conséquences et les besoins tangents d’une action dirigée par des enfants en leur laissant l’organiser, la gestion se résumant ici à ce qu’ils ne peuvent légalement faire (signer un devis, engager des dépenses par exemple). Comme vous le dites, c’est une condition, donc un rapport social construit sans rien d’inné, mais il n’y a pas que le jeu qui permette de dépasser ça, et le but du jeu n’est pas de permettre aux adultes d’exercer un contrôle social par une illusion de liberté.
Je ne suis pas sûr de comprendre tout le reste de ce que vous dites, je me contenterais d’espérer que les critiques le jeu de Prothières (quelques instants de recherche me font aboutir à In Extremis, est-ce bien cela?) portent sur le techno-solutionnisme et non sur le constat de fond du GIEC caricaturé sous le nom de GIETE. Mais le manifeste indique bien la possibilité (et non l’obligation) de jouer à un jeu dont on ne valide pas l’enjeu ou les éléments, pour le plaisir de la mécanique. A chacun·e de mettre sa limite, la mienne ayant par exemple exclu des jeux dont l’auteur·ice est d’un bord auquel je m’oppose, ce qui ne fait pas entrer le thème ou la mécanique dans la considération, ce qui à mon sens montre que considérer uniquement le thème ou la mécanique, comme de ne pas les considérer, ne permet pas de faire le tour de l’éthique nécessaire au jeu (et, comme dirait Lefèvre, aux conditions de sa reproduction).
morlockbob 20/03/2025
Le manifeste a peut être été livré trop brutalement, ces précisions, questionnement, permettent de mieux comprendre. Merci.
Gobarkas 21/03/2025
Merci pour le partage de ces très intéressantes réflexions complémentaires.
Conan le berbère 21/03/2025
En gros, tout ça revient à la considération de l’existence d’une neutralité du jeu, hors positivité et négativité.Pour pouvoir jouer hors de la « conscience » – avec ou sans sentiment de culpabilité, celà nécessite de poser le jeu comme une technologie (c’en est une) neutre.
Je rappelle la constatation de la considération des impacts de la technologie par Kranzberg: Technology is neither good nor bad; nor is it neutral (1986. Technology and History: « Kranzberg’s Laws »Technology and History. in Technology and Culture. vol.27 n°3 pp544-560.)
C’est à la suite d’Ellul que Kranzberg, qui n’est pas un luddite (on peut davantage mécomprendre Ellul sur ce point si on ne va plus loin que les résumés de son oeuvre), postule que la technologie procède nécessairement d’un choix, d’une décision, qui favorise dans son invention, son application ou dans sa non-application (sa censure pourrait-on dire) une ou plusieurs finalités.
Il en va donc ainsi pour le jeu. Il s’agit alors non pas de refuser les choix, mais d’en comprendre les tenants et aboutissants – et ce qu’il faut refuser, c’est cette position hors du temps et de la société où les choix n’ont pas d’impact. Cela devrait être assez évident pour n’importe quel eurogamer pour qui la chaîne des actions découle d’un choix initial, en les en privant d’autres, et en privant les autres du choix qu’on a fait par la pose d’un pion dans une case dont on revendique l’exclusivité.
Dès lors il s’agit effectivement de morale ou d’éthique. La morale, ou l’éthique, ce ne sont pas des gros mots, ni forcément des choses définitives, ou même personnelles, dont on porterait soi la culpabilité entière. Mais il s’agit quand même de choix, que l’on fait par rapport à soi et un collectif plus large où nos actions comptent.
On peut lire ou relire cette lettre d’Umberto eco à son fils
http://filierelangages.free.fr/textes/Eco.htm (paru chez 10/18 dans un recueil avec d’autres écrits très intéressants du Diario Minimo, c’est plutôt facile à lire pour du Eco, je le conseille fortement)
sur les jouets qu’il lui offrira ou non à Noël. On peut y remarquer le poids de l’Histoire, mais également se demander ce que les années de plomb qui suivront peu après sa publication, peuvent nuancer dans cet écrit polémique – un manifeste, personnel, d’une éthique du jeu comme transmission.
Face à cela, il faut aussi comprendre pourquoi on se sent attaqué par cette injonction à mettre de l’éthique dans le jeu (en réalité une injonction à en considérer la possibilité plutôt qu’autre chose). Je vais reprendre quelques réflexions issues de mes lectures de Mona Cholet (Résister à la culpabilisation, Zones) et, justement d’un écrit qui n’est pas « censé » être éthique dans ce haut-lieu de l’escapisme qu’est la fantasy, Tehanu d’Ursula K Le Guin.
Quand on se sent attaqué ou aggressé par une obligation morale, ce n’est jamais anodin, ce n’est pas à repousser d’un trait de plume comme superficiel. Il s’agit, toujours selon moi, d’une réaction face à une impuissance, quelque chose qui nous dépasse. On est – sans cesse – pris entre plusieurs injonctions, des désirs aux obligations, et aucun choix ne permet de tout concilier.
Plus on s’écarte de la norme (pas péjorative ici) , plus les injonctions seront fortes: si tout le monde partage un écart éthique, il apparaît moins grave en comparaison. Ce message que je tape a un coût écologique, qui ne me sera pas reproché, car toute participante à cette discussion en a accepté sinon la responsabilité, du moins le principe. Mais si je m’insurge contre le coût écologique de telle ou telle chose par ce message, je m’expose à un écart éthique plus grand, car c’est ma propre définition que je choisis, de manière visible par tous et toutes, de piétiner. Moralité: mieux vaut ne pas établir un éthique trop exigeante si je ne veux pas, pour moi-même, me reprocher mes infractions.
Or je n’ai pas toutes les clés. Je n’ai pas le pouvoir de passer outre ces infractions à l’éthique: je ne peux pas communiquer avec des inconnus sur ce thème qui m’est cher, sans passer par une plateforme qui n’existe pas IRL. Je peux choisir de me taire, mais dans ce case, je me culpabilise aussi car je n’agis pas.
La seule manière de résoudre ce dilemme est de considérer que ces injonctions culpabilisatrices sont hors de moi. Cela veut dire également qu’elles doivent être hors des autres, et qu’on ne doit pas jeter systématiquement l’opprobre sur autrui, car la responsabilité est collective, personne n’est ni exonéré, ni seul coupable.
Cela permet de replacer la critique à un niveau systémique où toutes les remises en cause doivent se faire, non pour la satisfaction d’être meilleur que les autres, mais d’avoir le meilleur pour soi et les autres. Il me semble que c’est précisément ce que fait ce manifeste, en engageant ses auteures sur la voie du choix conscient mais pas coupable.
Pour référence, les éditions Zones proposent des extraits, et je pense que les pages 15 et 16 disponibles par ce lien peuvent être les plus éclairantes ( https://www.calameo.com/read/000215022da908f08851d ).
Bertrand 21/03/2025
Merci Pierre pour cet article ! J’ai pris le temps de me poser pour le lire de bout en bout et de réfléchir à ma propre définition du jeu et cela fait extrêmement de bien…
Si tous les énervés du clavier pouvaient se poser quelques minutes pour réfléchir au fond du sujet ou tout simplement respirer un peu, le monde (dont celui d’internet et des réseaux) serait plus apaisé et gagnerait en interactivité constructive !
Pascal TERRACOL-CHAMPIN 25/03/2025
Je confirme, après plusieurs lectures très attentives, après avoir noté dans la marge mes interrogations, le rédactionnel de ce Manifeste métaludique est flou, confus. De prime abord il est difficile de trouver une cohérence entre les 3 chapeaux numérotés et le développement rédigé. J’en suis même à constater que ce collectif enfonce souvent des portes ouvertes.
Force est de constater que la déception a suivi la lecture de ce document qui cherche ses mots à tel point que ce manifeste semble être un jeu d’énigmes qui renferme beaucoup d’indices repérables après plusieurs lectures. L’appel en conclusion à la constitution de collectifs en résidence, dévoile pudiquement où ce collectif veut en venir, en mode « comprenne qui voudra ».
Avant de lire ou relire ce manifeste, il n’est pas inutile de lire la définition du mot MANIFESTE dont le synonyme est « profession de foi ».
Ultérieurement je développerai, point par point, ma compréhension de chacun des 3 points.
Si je soutiens la libre expression, je peux déjà affirmer que je rejette fermement ce manifeste qui appelle à la prise d’otage du jeu de société au service du camp du bien pour changer notre société fruit de 2000 ans d’histoire.
Peut-être serez vous choqués ou vivement titillés par mes prochaines analyses. Mais si vous soutenez la liberté d’expression non insultante et non diffamante, cela pourrait être intéressant à plus d’un titre.
A suivre donc.
Michel 15/04/2025
Gaffe à l’utilitarisme, tout de même…
PS : le point 2 du manifeste enfonce ostensiblement et avec fracas des portes ouvertes depuis des lustres.